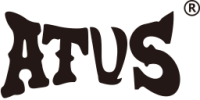Depuis des décennies, fumer est reconnu comme l’une des habitudes les plus addictives, responsable de millions de décès évitables chaque année. Ces dernières années, le vapotage, présenté comme une « alternative plus sûre », a connu un regain de popularité, notamment auprès des jeunes. Pourtant, à mesure que les experts en santé publique approfondissent la question, une question cruciale se pose : quelle habitude est la plus difficile à arrêter ? La réponse n’est pas simple, car toutes deux reposent sur la nicotine (principale substance addictive), mais diffèrent par leur composition chimique, leurs déclencheurs comportementaux et leurs perceptions sociétales, autant de facteurs qui influencent la difficulté de s’en libérer.
1. Les fondements chimiques de la dépendance
Au cœur de ces deux habitudes se trouve la nicotine, un stimulant qui se lie aux récepteurs cérébraux, libérant de la dopamine et créant une sensation de plaisir. Cependant, le mode d’administration de la nicotine, ainsi que les autres substances chimiques présentes dans chaque produit, varient considérablement, modifiant ainsi l’intensité de la dépendance.
Les cigarettes traditionnelles contiennent plus de 7 000 substances chimiques, dont le goudron, le monoxyde de carbone et le formaldéhyde, qui provoquent de graves lésions pulmonaires et le cancer. La nicotine contenue dans les cigarettes se présente sous forme de « base libre », absorbée lentement dans le sang ; les fumeurs inhalent généralement 1 à 2 mg de nicotine par cigarette, avec un pic cérébral après 10 à 15 minutes.
Les vapoteuses, quant à elles, chauffent un liquide (e-liquide) contenant de la nicotine, du propylène glycol, de la glycérine et des arômes (par exemple, fruits, menthe ou dessert). De nombreuses vapoteuses utilisent des « sels de nicotine », une forme de nicotine imitant la structure naturelle des feuilles de tabac. Les sels de nicotine sont absorbés 2 à 3 fois plus rapidement que la nicotine base libre, atteignant le cerveau en seulement 3 à 5 minutes. Elles permettent également des concentrations de nicotine plus élevées (certains e-liquides contiennent 50 mg/ml de nicotine, soit l’équivalent de 20 cigarettes par dosette). Cette dose rapide et intense de nicotine peut renforcer la dépendance physique plus rapidement que le tabagisme, car le cerveau apprend à désirer cette récompense immédiate.
2. Attaques comportementales et psychologiques
L’addiction n’est pas seulement physique : elle est aussi liée aux habitudes et aux émotions. Fumer est depuis longtemps associé à des rituels : allumer une cigarette après un repas, la tenir dans ses mains pendant une conversation ou l’utiliser pour gérer le stress. Ces gestes s’ancrent dans le quotidien, faisant de l’arrêt du tabac une question de rupture avec la routine autant que de lutte contre les envies de nicotine.
Le vapotage, cependant, ajoute de nouvelles dimensions psychologiques. La large gamme de saveurs (par exemple, fraise, vanille ou chewing-gum) le rend plus attrayant, notamment pour les jeunes utilisateurs qui ne sont pas forcément attirés par le goût prononcé du tabac. Pour de nombreux vapoteurs, personnaliser leur appareil (ajuster la puissance, remplir leur e-liquide) ou savourer une saveur sucrée devient une forme de divertissement, et non pas seulement une solution à la nicotine. Ce lien émotionnel, associé au mythe selon lequel le vapotage est « inoffensif », réduit la motivation à arrêter. Une enquête menée en 2023 par les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a révélé que 68 % des vapoteurs estiment que leur habitude est « bien moins nocive » que le tabagisme, et que seulement 32 % prévoient d’arrêter dans l’année, contre 45 % des fumeurs.
3. Taux de réussite au sevrage : les données parlent
La recherche dresse un tableau clair des défis. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) a suivi 10 000 adultes ayant tenté d’arrêter de fumer ou de vapoter. Après six mois, 23 % des fumeurs avaient réussi à arrêter, contre seulement 15 % des vapoteurs. L’écart s’est creusé après un an : 18 % des fumeurs restaient non-fumeurs, tandis que seulement 9 % des vapoteurs avaient arrêté la cigarette électronique.
Pourquoi cette différence ? Les fumeurs ont accès à des outils d’aide au sevrage plus reconnus : thérapies de substitution nicotinique (TSN, comme les patchs ou les gommes), médicaments sur ordonnance (comme la varénicline) et groupes de soutien. Les vapoteurs, en revanche, peinent souvent à trouver une aide ciblée. De nombreux TSN sont conçus pour s’adapter à la libération lente de nicotine des cigarettes, et non à la rapidité des vapoteuses, ce qui les rend moins efficaces pour les utilisateurs de cigarettes électroniques. De plus, les vapoteurs sont plus susceptibles de pratiquer le « double usage » (alterner entre vapotage et tabac) que les fumeurs d’adopter le vapotage, ce qui complique les tentatives d’arrêt. Une étude de 2021 publiée dans le British Medical Journal a révélé que 40 % des vapoteurs qui tentent d’arrêter finissent par fumer à nouveau, contre 25 % des fumeurs qui rechutent.
4. Le sevrage : un combat différent
Les symptômes de sevrage constituent un obstacle majeur à l’arrêt du tabac et diffèrent considérablement entre le vapotage et le tabagisme.
Les fumeurs ressentent généralement des symptômes physiques intenses dans les 2 à 4 heures suivant leur dernière cigarette : maux de tête, nausées, oppression thoracique et irritabilité. Ces symptômes atteignent leur paroxysme après 1 à 3 jours et s’atténuent progressivement sur 2 à 4 semaines. Leur intensité est souvent liée à la durée de la consommation : les fumeurs de longue date peuvent ressentir une gêne physique plus intense, mais les symptômes sont prévisibles et de courte durée.
Les vapoteurs, quant à eux, signalent un sevrage physique plus léger, mais des envies psychologiques plus fortes et plus durables. L’attrait du vapotage étant lié au goût et au rituel, les envies évoquent souvent des souvenirs du goût (par exemple, « Je veux cette bouffée mentholée ») ou de l’utilisation de l’appareil (par exemple, prendre la vape pendant une pause au travail). Une étude de 2023 menée par l’Université de Californie à San Francisco a révélé que les vapoteurs ressentaient des envies pendant en moyenne 6 semaines après avoir arrêté, soit deux fois plus longtemps que les fumeurs. De nombreux vapoteurs signalent également un « manque de saveur » : un désir persistant pour leur e-liquide préféré, non pris en charge par les TNS traditionnels.
5. Défis spécifiques à la population
La difficulté d’arrêter de fumer dépend également de la personne qui utilise le produit. Pour les adolescents et les jeunes adultes, qui représentent 40 % des vapoteurs, arrêter est particulièrement difficile. Le cerveau des adolescents est encore en développement et la nicotine peut altérer définitivement les voies de récompense, accélérant et aggravant la dépendance. Une étude des CDC de 2022 a révélé que 75 % des adolescents vapoteurs qui tentent d’arrêter rechutent dans le mois, contre 50 % des adolescents fumeurs. Les jeunes vapoteurs subissent également la pression de leurs pairs : le vapotage étant plus acceptable socialement que le tabagisme à l’école et dans les cercles sociaux, il est plus difficile d’éviter les déclencheurs (par exemple, les amis qui vapotent en soirée).
Pour les fumeurs plus âgés, le défi réside dans la dépendance physique à long terme. Une personne ayant fumé un paquet par jour pendant 20 ans peut avoir développé une tolérance à la nicotine, nécessitant des doses plus élevées pour être satisfaite. Arrêter de fumer peut déclencher des symptômes physiques graves, mais les fumeurs plus âgés ont souvent une motivation plus forte : la peur du cancer du poumon, des maladies cardiaques ou le désir de donner le bon exemple à leur famille. Cette motivation peut compenser l’inconfort physique, ce qui entraîne des taux de réussite plus élevés que les vapoteurs plus jeunes.
Conclusion : Cela dépend, mais le vapotage pose souvent de plus grands obstacles
Il n’existe pas de réponse universelle à la question de savoir lequel est le plus difficile à arrêter, mais pour la plupart des gens, et en particulier les jeunes, le vapotage présente des défis uniques. Son administration rapide de nicotine, ses saveurs attrayantes et sa réputation de « sûr » créent une dépendance physique et psychologique plus forte. Les fumeurs, confrontés à un sevrage intense à court terme, bénéficient de davantage d’outils de soutien et d’une meilleure sensibilisation aux risques pour la santé.
En fin de compte, l’arrêt de l’une ou l’autre de ces habitudes nécessite un effort personnalisé. Pour les vapoteurs, trouver un traitement de substitution nicotinique sans arôme ou un accompagnement psychologique adapté aux envies rituelles peut être utile. Pour les fumeurs, combiner médicaments et groupes de soutien donne souvent les meilleurs résultats. L’essentiel est de reconnaître que la dépendance est une maladie traitable, et non un échec moral. Que vous soyez fumeur ou vapoteur, consulter un professionnel est la première étape vers la libération. Le chemin peut être long, mais la récompense – une meilleure santé, plus d’énergie et la libération des envies – en vaut la peine.